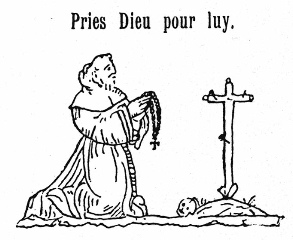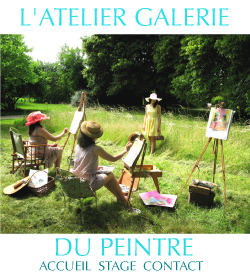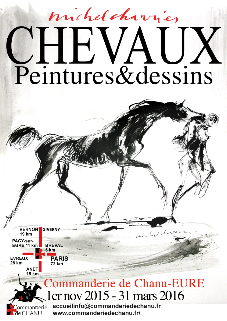La fondation de La Commanderie de Chanu, notamment l'édification de la chapelle se situe à la moitié du XIIe siècle, le style de l'édifice romano-gothique le confirme. Plus précisément après 1145. A cette date la bulle Militia Dei a été publiée par le pape Eugène III, elle permit aux Templiers de construire leurs propres oratoires.
La plupart des commanderies des Templiers ont été établies à la suite de donations faites à l'Ordre qui est devenu en quelques années par son dévouement total aux croisades, au péril de la vie des moines soldats, un ordre admiré et encouragé par tout l'occident Chrétien.
La Commanderie de Prunay le Temple, située à quelques lieues sur l'ancien chemin conduisant à Paris, a été en étroite et constante relation avec Chanu, elle a été fondée à la suite de la donation du domaine entier aux Templiers par le seigneur Simon d'Anet.
L'Ordre du Temple a reçu le domaine de Chanu des mains de ce seigneur en témoignage de son soutien aux Chevaliers par grande piété et charité. Au jour de l'enterrement de son fils Jean de Bréval en l'an 1189, il sera mis en terre à la Chapelle de Chanu.
«Au-dit lieu de Chanu, y a une chappelle fondée de Nostre Dame du Temple, chargée de trois messes par semaine. Auprès de la chappelle et dedens le villaige, est la maison de la commanderie qui a été refaicte à neuf par le commandeur actuel,frère Nicole Louchart, chappelain».
« En ladite maison, le Commandeur a toute justice, et pareillement sur le villaige où sont environ XXXVI feuz, tous justiciables et subjects de la commanderie et justice levée » (Visite prieurale de 1495).
La Maison du Temple de Chanu était située le long du chemin de Vernon à Dreux.
Lorsque les Hospitaliers reçurent la Commanderie au début Du XIVe siècle, ils héritèrent d'un domaine de plus de 130 hectares que les Templiers avaient constitué par des défrichements et des dons en terre. Ils allaient dès lors la transformer progressivement en une véritable seigneurie en étendant leurs droits et leurs domaines. Celle-ci courait sur les paroisses d'Heurgeville et de Chanu ainsi que sur le fief du Hallot et le fief Bataille, situé dans les paroisses de Bueil, Chanu, Villiers et Saint-Chéron.
Le commandeur, véritable seigneur temporel, y possédait un droit de justice, percevait de nombreuses rentes en nature ou en argent tels les dîmes et le champarts.
Il possédait aussi une grange dîmière à Heurgeville qui lui permettait d'entreposer une partie des récoltes perçues, ainsi que deux moulins sur un petit étang situés un peu au nord de Chanu et certainement reconstruits à la même époque que le logis seigneurial.
Ces deux moulins à eau, alors connus sous les noms de Moulin d'en Haut et de Moulin d'en Bas étaient loués par les Hospitaliers avec logement pour le meunier et vingt arpents de terre.
Peu nombreux, ces derniers préféraient en effet tirer des revenus de leurs terres plutôt que de les exploiter directement ; ils les affermèrent progressivement et aux XVIIe et XVIIIe siècles leur domaine avait diminué de moitié.
Seigneur spirituel enfin, le commandeur nommait les desservants des paroisses d'Heurgeville et de Chanu et un passage aujourd'hui dans le mur mitoyen séparant la Commanderie de l'église Saint-Pierre lui permettait d'y accéder directement.
Si les noms des différents commandeurs qui se succédèrent à partir du XVe siècle sont connus, ceux de la période templière sont aujourd'hui oubliés à l'exception du frère Simon de Quincy qui dirigeait la Commanderie à la fin du XIIIe siècle au moment où les Templiers se replièrent en Europe.
Parmi les plus célèbres sans doute faut-il retenir les noms de Claude de la Sangle, commandeur de 1525 à 1533, qui devint le Grand Maître de l'Ordre en 1554 et d' Albert de Roncherolles, commandeur de 1672 à 1697, issu de la famille des seigneurs de Pont Saint-Pierre qui portait le titre de Premier Baron de Normandie. Le dernier commandeur le frère François de Lombelon des Essarts, résidait peu à Chanu et la Révolution vint le surprendre à son domicile parisien juste avant que la Commanderie ne soit déclarée bien national et vendue.
Sources : Pierre MOLKHOU, Les chevaliers du Christ - Les Confluences de la Mémoire - 1996.
Chanu d'après les documents du Procès
Pour expliquer l'absence de documents anciens sur le Temple de Chanu et ses dépendances. Le Livre-Vert nous fait connaître le revenu de cette maison en 1373. II n'était que de vingt livres seize sols huit deniers, à cause de l'état de ruines où la guerre avait plongé la commanderie. Les 160 arpents de terre qui formaient le domaine de Chanu ne rapportaient alors que huit livres.
Nous avons dit que frère Simon de Quincy, précepteur de la baillie du Temple de Prunay, était venu à deux reprises, vers les années 1291 et 1295, en la maison du Temple de Chanu ; dans ce second cas, Simon est même donné comme précepteur de la maison, « Procès, tome II, pages 311, 384 » : « de Themis » alias « de Chounes. »
C'est assurément de Chanu dont il est question dans le journal du trésor du Temple :
Le 4 juillet 1295, de preceptore Ville Dei et Chamitarum (sic, pour : Chanutarum) 304 livres, etc.
Le 3 juillet 1296, de preceptore Chamitarum 22 livres, etc.
De Herberto Flamingo 80 livres, super preceptorem Chamitarum, etc.
« Mémoire sur les opérations financières des Templiers, pages 176, 809 »
Sources : Trudon des Ormes : Les possessions templières recueillies durant les interrogatoires des templiers par les hommes de Philippe le Bel et les commissions pontificales des diocèses de France.
Procès des Templiers, tome II, page 341
Item frater Robertus de Momboin, etatis quadraginta annorum, juratus eodem modo de se et aliis in causa fidei plenam, puram et integram dicere veritatem, et requisitus de tempore et modo sue
recepcionis, dixit per juramentum suum quod fuit receptus in domo de Themis in ballivia de Prunay, per fratrem Symonem de Quinci * preceptorem dicte ballivie, sexdecim anni sunt elapsi vel circa, presentibus fratribus Guillelmo de Braie et fratre Egidio Monachi militis, et quibusdam aliis fratribus de quorum nominibps non recolit.
Sources : Procès des Templiers, publié par M. Jules Michelet, tome 1 et 2 - Imprimerie Nationale - Paris - M. DCCC. LI.
Procès des Templiers, tome II, page 384
Item frater Johannes de Chounes, etatis XXXII annorum, juratus eodem modo de se et aliis in causa fidei dicere veritatem, et interrogatus de tempore et modo sue recepcionis, dixit per juramentum
suum quod fuit receptus in domo de Chounes per fratrem Symonem de Quinci* preceptorem dicte domus, XII anni sunt elapsi, presentibus fratre Galtero de la Sotiere et quibusdam aliis de quorum nominibus non recolit.
Sources : Procès des Templiers, publié par M. Jules Michelet, tome 1 et 2 - Imprimerie Nationale - Paris - M. DCCC. LI.
*Frère Simon de Quincy dit Le Chaperon(en décembre 1306) a été nommé en Pouilles. On le retrouve à Marseille en 1303 où il a présidé à la réception de frères qu'il a emmenés à Chypre. On a retrouvé sa pierre tombale à Barletta : "Ci git Simon de Quincy, maître des Maisons du Temple dans le royaume de Sicile qui mourut le mercredi 7 juin 1307. Que son âme vive dans le Christ."
(Alain Demurger/Jacques de Molay, F.Tommasi,"Fonti epigrafiche dalla domus templi di Barletta per la cronotassi degli ultimi maestri provinciali dell'ordine nel regno di Sicilia", dans Militia Sacra. Gli ordini militari tra Europa e Terrasanta.)
Deux fiefs relevaient de la seigneurie de Chanu :
le fief de « Hallot
Le Fief du Temple d'Hallot », commune de Villiers-en-Désoeuvre, appartenant en 1761 à Charles de Bence, chanoine d'Evreux, Jean-Baptiste de Bence, curé de Serez, son frère, et autres, et comprenant une maison avec des terres sur le chemin d'Heurgeville à Lommoye.
Le second fief, nommé le fief « Bataille
Fief du Temple de Bataille», s'étendait dans les paroisses de Chanu, Villiers-en-Désoeuvre, Saint-Chéron et Bueil, avec droit de basse justice sur les vassaux tenant héritages, droits de cens, champart, etc. Il appartenait en 1763, à Louis-Antoine-François Doublet; chevalier, seigneur de Lorey, Saint-Chéron et Villegats.
COMMANDEURS DE CHANU, Hospitaliers, ORDRE DE SAINT JEAN DE JERUSALEM
| 1312 - 1319 1356 1375 1391 1413 1424 1460 1491 1495 1525 1539 1556 1595 1601 1613 1628 1650 1662 1672 1697 1701 1713 1715 1726 1731 1740 1742 1763 1767 1781 1787 |
: Bernard d'Arles : Frère Pierre de Lapion : Frère Robert Piel : Chevalier Simon de Richaumont : Chevalier Henry de Bye : Frère Gérard Christophe : Chevalier Nicole de Giresme, Grand Prieur de France : Frère Jehan Prévost : Frère Nicole Louchart : Chevalier Claude de la Sangle : Chevalier Jehan de Vielz-Maison : Chevalier Nicolas de Feuguerolles : Chevalier Jean de Guyons : Chevalier Jean de Guernat : Chevalier Pierre de Vindax : Chevalier Jacob de Foyal d'Allonne : Chevalier Pierre des Guetz-de-la-Pottinière : Chevalier François de Brevillers de Coursans : Chevaliers Albert de Roncherolles : Chevalier Ferdinand Olier de Nointel : Chevalier Eustache de Bernard d'Avernes : Chevalier Henri Perrau de Saint-Dié : Chevalier Guillaume de la Salle : Chevalier Hyacinthe du Glas d'Arency : Chevalier Christophe Edouard de Thumery-Boissise : Chevalier de Lancry de Prompleroy : Chevalier Pierre Louis de Brévédent de Sahure : Chevalier Charles-Marie de Guines de Bonnières : Chevalier Charles-Claude de Rouvroy de Saint-Simon : Chevalier Antoine-Jérôme Tartarou de Moutiers : Chevalier François-Marie de Lombelon des Essarts |
REMERCIEMENTS
Sources : les commanderies du Grand-Prieuré de France - Eugène Mannier - Paris, Aubry et Dumoulin, 1872 (Paris)http://www.templiers.net/departements/sources-commanderies.html
Remerciements pour la rédaction de cette page d'histoire de La Commanderie de Chanu à :